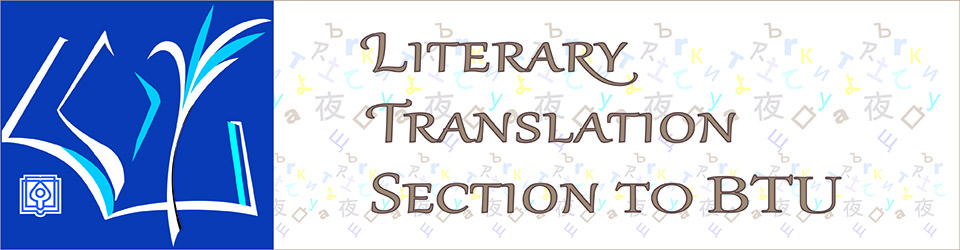The novel Dilettant by Bulgarian modernist writer Tchavdar Moutafov has just been published for the first time in French. The novel has been translated by our colleaugue Krasimir Kavaldjiev. The book has been published for the first time in 1926 in Bulgaria and is considered emblematic for Bulgarian literary modernism.
The novel Dilettant by Bulgarian modernist writer Tchavdar Moutafov has just been published for the first time in French. The novel has been translated by our colleaugue Krasimir Kavaldjiev. The book has been published for the first time in 1926 in Bulgaria and is considered emblematic for Bulgarian literary modernism.
In France the novel is published by Le Soupirail with the support of the Bulgarian National Book Center under the National Palace of Culture. Its presentation is scheduled for Ferbruary 16 in the Bulgarian Cultural Center in Paris.
An extract from Dilettant follows:
Tchavdar Moutafov, Le Dilettante (extrait)
traduit du bulgare par Krassimir Kavaldjiev
© Éditions Le Soupirail, 2016
J’aime les parfums, les sons, j’aime les couleurs, les teintes vives dans la rue en fête, j’aime tout ce qui me sidère et m’assujettit à la vie : j’aime ma déchéance. Je suis faible, je le sais, et mes sens convoitent la beauté, mon âme n’a pas la force de combattre les objets et leurs assauts mystiques ; même quand elle les renie, elle leur est soumise. Mes yeux sont assez soumis, peut-être trop : ils laissent passer la lumière pleine de leurres, et ils périssent, avides, dans la terreur colorée des choses. Ils brûlent en jetant des étincelles au dur contact avec la matière, et dans mes yeux semblent s’exécuter des sacrifices : ce sont les mirages expirants de l’âme.
Ah ! j’aime les parfums, ces images presque spirituelles de la matière : l’odeur du bois blanc verni ; l’étrange enivrement d’essence et de caoutchouc que répandent en été les automobiles dans la rue asphaltée ; l’haleine mystique d’un piano ouvert, tel un murmure de son âme musicale ; le parfum séduisant et douloureux des gants de bal mêlé à la poudre, l’arôme d’un corps féminin et la fumée de cigarette ; j’aime les effluves du luxe, du sport et de la danse ; les émanations des vêtements d’été propres séchés au soleil, l’odeur des canapés de cuir et le dangereux arôme des étuis à bijoux de velours.
J’aime le parfum des orchidées – cette pure odeur de corps nu et de péché ; j’aime l’ambre en hiver, quand les stores sont baissés, au milieu des contes blêmes de la cheminée de faïence ; j’aime l’héliotrope autour d’un verre de sherry et au milieu de gros éventails de plumes serrées à l’aide d’agrafes en or ; j’aime le fantastique nerveux et voluptueux de la Peau d’Espagne[1] rouge comme le sang, amer comme le poison, brûlant la peau comme un baiser. J’aime l’iris, le trèfle, la lavande et le musc ; les flacons carrés de cristal aux bouchons d’argent ; les effluves embaumés et éthérés d’une armoire ouverte ; l’arôme assoupi des vieux canapés de bois rose tapissés de soie ; j’aime l’odeur des chats, du corps enfantin et des cheveux féminins.
Hélas ! j’ai mes habitudes, de stupides petites habitudes de la grande ville, ridicules et chères comme un conte de fées. J’aime passer sous des fenêtres ouvertes derrière lesquelles on joue du piano ; j’aime le fracas d’un fiacre attardé la nuit dans une rue déserte ; j’aime les klaxons des automobiles, les signaux des locomotives de manœuvre, le rugissement matinal des sifflets d’usines. J’aime le rire des femmes devant les tables de marbre et les grandes vitrines ; le bruit vague et nerveux des hôtels ; les sons de l’orchestre mêlés au tintement de cristal sur la table du déjeuner ; le claquement sec des boules de billard, les coups ensommeillés de l’horloge, la musique des automates. J’aime l’écho d’un orchestre lointain qui joue une marche de parade ; la triste vanité des cloches ; le chant de la pluie de printemps, le frou-frou du linge des femmes, le souffle du vent qui soulève un pan de rideau de soie. J’aime le moment de silence incertain des foules, le calme étrange des églises, les heures d’après-midi dans les restaurants silencieux, l’apaisement nerveux du jour de fête ; j’aime le faible murmure de la prière.
Ah ! mon âme brûle d’envie pour les murmures, les sons, les cris – pianissimi rêvés de violons ; elle convoite le doux poison des hauts-bois, l’appel flou et mystique des cors de chasse. Mon âme convoite les sons qui transpercent l’espace comme des flèches, les doux fils démêlés de consonances, le crépuscule parfumé et sonore d’harmonies. Je m’afflige des soirées saintes et solennelles dans la salle de musique, lorsque dans l’orchestre se déchaînent les rêveries de l’âme dans des éclats purs ; les cantilènes dans les violons, les chromatismes dans les instruments en bois ; les tubes qui dédoublent le rythme pour le précipiter, à travers les trombones, dans un appel audacieux et jubilatoire ; la tempête et le cri de mort des timbales et des cymbales ; la mort de Siegfried : tam-tam !
C’est alors que survient le cri des couleurs, le tam-tam du bleu outremer, la mélodie de l’ocre, les consonances du pourpre. S’allument alors des feux, des étoiles de rubis, des lunes d’émeraude, des soleils d’opale ; de courts rayons scintillent tels des épées, de doubles orbites s’entrelacent, des éventails spectraux se déploient. Ah ! l’ivresse des couleurs : voir des arcs, des éclats, des lignes dentelées, des points tranchants. L’avidité des yeux de transgresser la limite du visible, les rayonnements qui carbonisent l’âme jusqu’à l’os, le chant bruyant des couleurs dans le sang. Le bariolage des surprises : le pan d’un ciel d’or sombre, gravé de minces filets d’arbres noirs ; les ombres de la lumière électrique dans lesquelles les objets paraissent rouge foncé ; les reflets phosphorescents dans un étang par une nuit de lune. Oh ! la bigarrure soudaine des foires, les couleurs ardentes des affiches, les feux d’artifice et les projecteurs du soir : la rue ivre de nuit.
Teintes flamboyantes, coloris lumineux, ces cris stridents d’oiseaux de feu, couleurs qui arrachent à l’âme des étincelles : teintes magiques de faste et de luxe ; les lumières, les lumières qui chantent : l’électricité, l’acétylène, le gaz aérien, le feu de Bengale. Je les désire à mort, jusqu’au crime, jusqu’au blasphème : je désire les feux de l’enfer…
Ah ! je voudrais être lumières et sons et parfums, transformer ma vie en un seul mirage éternel de beauté ; mes pauvres sens sont fort avides, trop avides, et c’est en vain que mon âme meurt foudroyée. Je le sais : je suis esclave de la vie et je cherche inutilement sa beauté. Je sacrifie en pure perte ma sombre et douce rêverie. Car je péris – et je savoure ma perte. J’aime la vie !
[1] En français dans le texte. Parfum très complexe et luxurieux qui existe depuis le XVIème siècle. Initialement conçu pour parfumer le cuir, il est ensuite adapté à un usage cosmétique. (NDT)